Liberté d’opinion, de croyances et de vie spirituelle : bonnes pratiques en ESSMS
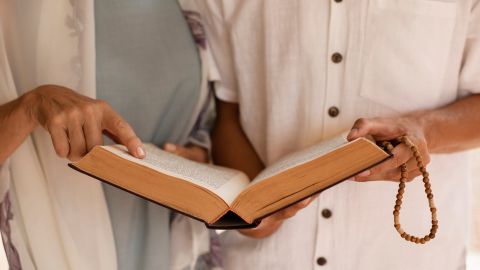

Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), la garantie de la liberté d’opinion, de croyances et de vie spirituelle des personnes accompagnées est essentielle.
Ces libertés fondamentales sont non seulement des droits humains, mais aussi des piliers du bien-être et de l'épanouissement personnel.
Leur respect et leur promotion au sein des ESSMS contribuent à créer un environnement inclusif et respectueux des diversités culturelles et spirituelles des personnes accompagnées.
Découvrez dans cet article comment les professionnels peuvent soutenir et promouvoir la liberté d’opinion, les croyances et la vie spirituelle, en mettant en œuvre des actions concrètes et en se posant les bonnes questions pour améliorer constamment leurs pratiques.
Voir aussi notre article : Droit électoral des résidents : comment garantir et soutenir ce droit en ESMS ?
Liberté d’opinion : que dit la loi ?
La liberté d’opinion est un droit fondamental inscrit dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) du 26 août 1789.
Dispositions de l'article 10
L’article 10 de cette déclaration stipule : "Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi."
Cette disposition affirme que chaque individu a le droit de formuler et d’exprimer ses opinions, y compris ses convictions religieuses, tant que cela ne perturbe pas l’ordre public.
Extension à la liberté religieuse
La Déclaration de 1789 précise que la liberté d'opinion ne se limite pas à la sphère politique, mais s'étend également à la liberté religieuse, englobant la liberté de croire ou de ne pas croire.
Ainsi, chaque individu peut pratiquer sa religion ou s'en abstenir sans crainte de répercussions, tant que cela respecte les règles de la société et ne génère pas de désordre public.
Protection par la "force publique"
Parmi les droits fondamentaux de l'homme, la liberté d'opinion est protégée par la "force publique" selon l'article 12 de la DDHC.
Cela signifie que l'État a la responsabilité de garantir et de protéger cette liberté.
Limitations historiques
Cependant, cette protection n'a pas toujours été infaillible. L'histoire française montre des périodes où la liberté d'opinion a été mise à mal, notamment sous :
- La Restauration (1814-1815 et 1824-1830) : durant cette période, des mesures restrictives ont été imposées, limitant la liberté d'expression et de croyance.
- Le régime de Vichy (1940-1944) : des restrictions similaires ont été mises en place, limitant la liberté d'opinion et de croyance.
Ces périodes historiques montrent que, malgré la protection juridique, la liberté d'opinion peut être vulnérable et nécessiter une vigilance constante pour être préservée.
Liberté religieuse : que dit la loi ?
La liberté religieuse, tout comme la liberté d'opinion, est un droit fondamental inscrit dans plusieurs textes juridiques majeurs :
Textes juridiques majeurs
- La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (article 10) : ce texte fondamental stipule que chacun a le droit d'exprimer, de pratiquer, d'abandonner sa religion ou de ne pas avoir de religion.
- La Convention européenne des droits de l’Homme de 1950 (article 9) : elle renforce la protection de la liberté religieuse en stipulant que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
- La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de 2000 (article 10) : elle réaffirme que chacun a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Dimensions de la liberté religieuse
Ces textes garantissent plusieurs dimensions de la liberté religieuse :
- La liberté de croyance : le droit de croire en une religion ou en aucune.
- La liberté de culte : le droit de pratiquer sa religion librement.
- La liberté de ne pas avoir de religion : le droit de ne pas adhérer à une croyance religieuse.
Garanties par les pouvoirs publics
Considérée comme un droit fondamental, la liberté religieuse est garantie par les pouvoirs publics.
Une traduction concrète de cette obligation est l’existence des aumôneries dans les établissements publics tels que les prisons ou les hôpitaux, permettant aux croyants de pratiquer leur culte même lorsqu'ils sont retenus dans ces établissements.
Protection par la Convention européenne des droits de l’homme
La Convention européenne des droits de l’homme renforce cette protection en stipulant que "toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion" sans subir d'autres restrictions que "celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique [...]" (article 9).
En cas d’atteintes injustifiées à ces libertés, la Cour européenne des droits de l’Homme peut intervenir et sanctionner ces violations.
La laïcité en France
En France, la liberté religieuse est également protégée par la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État, qui établit la laïcité de la République.
Cette loi assure la liberté de conscience des citoyens et stipule que la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. En principe, la religion relève donc de la sphère privée et ne concerne pas la puissance publique.
La Liberté d’opinion, de croyances et de vie spirituelle dans le référentiel HAS
La liberté d’opinion, de croyances et de vie spirituelle est une composante essentielle des droits de la personne accompagnée.
Elle est intégrée dans le référentiel d’évaluation de la qualité des ESSMS sous la thématique "Droits de la personne accompagnée".
Plus précisément, elle est reprise au chapitre 2 et constitue un critère impératif pour l’objectif suivant :
OBJECTIF 2.2 - Les professionnels favorisent l’exercice des droits fondamentaux et des libertés individuelles de la personne accompagnée
🟥 CRITÈRE 2.2.4 – Les professionnels respectent la liberté d’opinion, les croyances et la vie spirituelle de la personne accompagnée
Pour atteindre cet objectif, plusieurs actions et outils sont mis en place, accompagnés de questions à se poser afin d’évaluer et d’améliorer les pratiques :
Questions à se poser
Expression libre des opinions
Les personnes accompagnées ont-elles la possibilité d’exprimer librement leurs opinions politiques, philosophiques et religieuses ?
Encouragement du libre arbitre
Les professionnels proposent-ils des actions qui encouragent le libre arbitre, telles que des lectures, des sorties ou des rencontres ?
Ressources et espaces de libre expression
L’ESMS propose-t-il des ressources, des temps, des espaces, des rencontres, et des ouvrages qui favorisent la libre expression ?
Information sur les droits civiques
Les jeunes majeurs et les adultes accompagnés sont-ils informés de leur capacité à exercer leur droit de vote ?
Liberté d’association
Les jeunes majeurs et les adultes peuvent-ils librement adhérer à des associations de leur choix ?
Éléments d'évaluation
Pour garantir le respect de ce critère, les professionnels doivent :
- Connaître les pratiques qui favorisent le respect de la liberté d'opinion, des croyances et de la vie spirituelle
- Partager ces pratiques entre eux
- Mettre en œuvre ces bonnes pratiques de manière cohérente et continue.
Décryptage des attendus
Afin de s'assurer que les attentes liées à la liberté d'opinion, de croyances et de vie spirituelle sont bien comprises et appliquées, les éléments suivants sont essentiels :
- Formations et groupes de parole : des formations et/ou des groupes de paroles portant sur ce thème doivent être organisés pour les professionnels.
- Connaissance et prise en compte des croyances : les croyances des usagers doivent être connues et prises en compte dans leur accompagnement.
- Supports de sensibilisation et protocoles : un support de sensibilisation et/ou des protocoles doivent être mis à disposition des salariés pour les guider dans leurs pratiques.
Focus sur les éléments de preuves
Pour évaluer la mise en œuvre effective de ces bonnes pratiques, plusieurs éléments de preuve peuvent être utilisés :
- Plan de formation : inclure des formations ou des sensibilisations spécifiques sur la liberté d’opinion, de croyances et de vie spirituelle
- Supports de sensibilisation : remettre ou afficher des supports de sensibilisation aux salariés
- Projet d'accompagnement personnalisé : mentionner les croyances de l’usager dans son projet d’accompagnement personnalisé.
- Comptes rendus de groupes de paroles : Documenter les discussions et les décisions prises lors des groupes de paroles sur ce thème.
En intégrant ces pratiques, les établissements peuvent non seulement se conformer aux exigences réglementaires, mais aussi créer un environnement respectueux et inclusif, où chaque résident peut vivre pleinement sa liberté d’opinion, de croyances et de vie spirituelle.
Cet article sur la liberté d’opinion, de croyances et de vie spirituelle vous a intéressé.e ? Restez informé.e des actualités de votre secteur en vous abonnant à notre newsletter.







